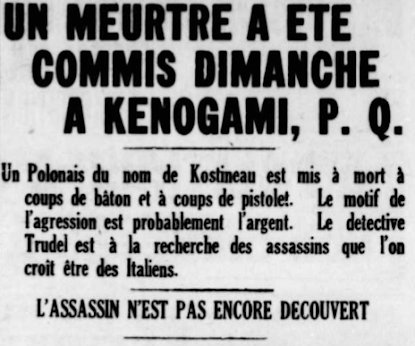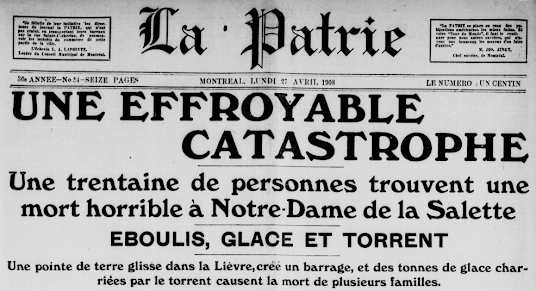|
| Pauline Garon (Le Soleil, 25 juillet 1931) |
 |
| La Patrie, 1er mai 1920 |
 |
| Pauline Garon (La Revue Moderne, 15 septembre 1922) |
"Pauline Garon, qui assiste M. Moore comme premier rôle, est une Montréalaise d'un charme et d'une beauté rares, et elle devient rapidement une favorite dans le monde cinématographique." (La Patrie, 17 juin 1922)
 |
| La Patrie, 17 juin 1922 |
Il s'agit de l'histoire d'un homme d'affaires dont la femme se sentant abandonnée par son mari retenu par ses nombreuses affaires, trouve des distractions dans la compagnie d'un homme qui prétend être le dictateur d'un État des Balkans. L'enfant de cette femme cependant, pour sauver l'honneur de sa mère et de sa famille trouve le moyen après de cruels sacrifices d'éloigner l'inconnu, ce qui donne alors lieu à des scènes des plus typiques. (La Patrie, 5 mars 1923)
 |
| La Patrie, 5 mars 1923 |
À l'automne 1924, le St-Denis propose "Force d'âme" ("The Power Within"), qui est en fait l'un des tous premiers films mettant en scène Pauline Garon (en Anglais, il était sorti en décembre 1921).
 |
| La Presse, 10 octobre 1924 |
"Force d'Ame, c'est l'histoire palpitante de Job Armstrong, en plein succès, qui a confiance en sa force d'énergie et de caractère et qui s'imagine qu'il est le maître du destin et du succès. Il est riche, il est puissant, il possède résidence princière et sa famille est heureuse. Mais vient la série de revers: sa fille meurt; son fils est tué; sa santé s'altère; il est ruiné peu à peu par son gendre et sa résidence est détruite par un incendie. Il est cependant près à recommencer la lutte, lorsque son petit fils disparaît. Alors, il est forcé de s'incliner et de reconnaître que le maître de la puissance et du destin, ce n'est pas lui, mais Dieu." (La Patrie, 4 octobre 1924)
"L'une des plus belles scènes de Pauline Garon, c'est celle où elle reconnait dans Bazaine le meurtrier de son mari. Elle l'attaque avec toute l'impulsion d'une jeune tigresse et parvient à s'emparer de son habit, dans les goussets duquel se trouve les détails du complot. La scène de la perte de l'enfant est également palpitante. (La Patrie, 4 octobre 1924)"
"Et, n'est-ce pas maintenant réellement le tour du patriotisme qui doit nous animer, en allant applaudir cette merveilleuse petite artiste qu'est Pauline Garon, et qui est nôtre, notre propre concitoyenne? Pauline Garon est une grande artiste, et dans ce rôle de la bru de Job Melford, son bon ange gardien, elle est admirable de qualités scéniques. Avec cela qu'elle possède en plus toutes les qualités physiques qu'on exige des étoiles américaines. (La Patrie, 10 octobre 1924)"
Un journaliste de La Patrie la rencontre à Montréal en février 1928.
"- Vous revenez pour quelques jours dans votre pays natal?
- Pour une semaine environ! J'arrive de New-York où j'ai obtenu mes papiers de naturalisation américaine et je vais m'embarquer pour Paris, je crois, dans l'intention d'y tourner un film avec une maison française.
- Vraiment! Vous êtes Américaine!
- Il le fallait bien! Je suis allée en France avec mon mari il y a quelque temps. J'ai voulu obtenir mes passeports. Impossible! Au consulat américain, j'étais sujet britannique. Au consulat anglais, j'étais Américaine. En réalité, je me trouvais, ayant deux pays, à n'être d'aucun. Situation embarrassante, vous l'avouerez, qui est maintenant réglée. " (La Patrie, 23 février 1928)
Pauline Garon a connu ses plus grands succès en jouant dans dans des films muets, mais vers la fin des années 1920, ce sont plutôt les films parlants qui ont la cote. À partir de 1930, la carrière de Pauline Garon prend une tournure différente: elle joue désormais dans des films parlants, tournés en français.
Le 11 mai 1930, elle parle du film "Le Spectre Vert", réalisé par Jacques Feyder.
"C'est, nous dit-elle, une production excessivement intéressante et d'autant plus qu'elle a trait au Canada. Vous serez peut-être étonnés de m'entendre parler avec un accent du plus pur parisien. Mais je jouais le rôle d'une petite Française et je devais par conséquent adopter l'accent du pays de Molière. Cela ne veut pas dire, comme le prétendent les Américains, que je ne parlais pas déjà correctement le français. Simple question d'accent!..." (Le Petit Journal, 11 mai 1930).
"Le Spectre Vert" tardera à être présenté au Québec. Toutefois, "Échec au Roi", son deuxième film parlant tourné en français, sort à Montréal en mai 1931, à grand renfort de publicité.
"Échec au Roi", que la direction présente cette semaine avec des acteurs de valeur dont notre jeune compatriote canadienne-française Pauline Garon, est une farce amusante et pleine de charme. L'intrique n'est pas très compliquée. Les rôles brillent par leur contraste: un roi démocratique, une reine autoritaire; une princesse jolie voulant se marier selon son coeur mais que l'on veut faire épouser au prince d'un État voisin, etc. Le Roi aime les échecs, la Reine les hait. L'action tourne autour de la révolution et du mariage de la princesse. Celle-ci, comme dans les contes de fée, finit par épouser le secrétaire du Roi." (L'Illustration, 4 mai 1931)
 |
| L'Illustration, 2 mai 1931 |
À la fin du mois de juillet 1931, Pauline Garon visite Montréal, puis ensuite Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Sa principale activité consiste à apparaître sur la scène juste avant chaque présentation d'un film, dans le cinéma qui a obtenu l'exclusivité de sa présence.
Elle arrive à Montréal par train le 19 juillet 1931, et est accueillie à la gare Bonaventure par une fanfare et une foule enthousiaste.
 |
| Pauline Garon lors de son arrivée à Montréal (La Presse, 20 juillet 1931) |
Le maire Camilien Houde la reçoit à l'Hôtel de Ville et lui remet symboliquement les clés de la ville.
 |
| Pauline Garon tenant la clé de la ville de Montréal (La Presse, 20 juillet 1931) |
À Montréal, c'est le théâtre Loew's, rue Sainte-Catherine, qui a l'honneur de présenter Pauline Garon "en personne" aux spectateurs qui dépensent 25 cents pour voir le film "Just a Gigolo". Un concours promet des vêtements à la jeune femme qui ressemblera le plus à l'actrice.
"De savants praticiens se penchent sur le cinéma, lui découvrent mille maladies et prédisent sa mort depuis qu'il est parlant. Or, Mlle Pauline Garon, cette sympathique compatriote qui connaît aussi bien son Hollywood que sa cité de Montréal (dont la population lui fait fête au Loew's cette semaine), envoie dans la lune toutes ces pauvres théories. Dans un sketch aussi bien construit que trop court, elle explique au spectateur ce qu'il a gagné depuis l'avènement du film parlant. Mlle Garon, mieux que nulle autre, peut indiquer ces variantes car elle a fait du film muet et du film parlé et celui-ci en deux langues: ils apprendront d'elles des tas de choses originales qui leur seront d'un grand secours. Il est inutile d'insister sur le charme de cette petite personne. Blonde, d'une espièglerie qui pourrait être facilement redoutable et d'un tempérament nerveux que l'on soupçonne impétueux, Mlle Garon en petite femme décidée fait son chemin dans la vie avec une crânerie et un courage qui en remontreraient à bien des hommes." (La Presse, 21 juillet 1931)
Quelques jours plus tard, Pauline Garon apparaît aux théâtres Capitol de Québec et de Trois-Rivière, puis au Granada, à Sherbrooke. À chaque endroit, des commerçants s'associent à la vedette: récepteurs radio de marque Philco, boissons gazeuses Claire Fontaine, manteaux de chez Fortin...
 |
| Le Soleil, 25 juillet 1931 |
 |
| Le Soleil, 27 juillet 1931 |
 |
| Le Nouvelliste, 31 juillet 1931 |
"Pauline Garon a fait une apparition sur la scène et a fait part de ses impressions sur d'Hollywood, avant et après l'avènement des films sonores. Elle a raconté comment les artistes doivent travailler dans les studios, où ils entrent de bonne heure le matin pour n'en sortir que tard le soir, après avoir passé la journée sous la férule d'un directeur et avoir repris la même scène une dizaine de fois, sinon plus. L'avènement des films sonores, cependant, a été considérablement profitable au cinéma, dit-elle.
L'assistance a applaudi la jeune Canadienne qui était ravissante à voir dans sa belle toilette que couronnait sa tête blonde. " (La Tribune, 1er août 1931).
Mais l'étoile de Pauline Garon décline rapidement. Après sa tournée québécoise de l'été 1931, on ne la mentionne plus que très rarement dans les journaux québécois. Déjà, en 1938, lors du décès de sa mère, la Patrie la décrit comme une "actrice canadienne-française qui connut un grand succès à l'écran américain au temps des films silencieux".
Quelques journaux annoncent son second mariage, en 1940, puis elle tombe dans l'oubli. Dans les journaux québécois, je n'ai trouvé aucune mention de son décès, survenu en 1965 en Californie.
 |
| Pauline Garon (Le Bien Public, 29 février 1940) |
Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)
Quelques articles qui pourraient vous intéresser:
- Le géant Beaupré arrive à Montréal (1901)
- Agnès Vautier, hockeyeuse étoile (1915-1919)
- Scandaleux marathons de danse à St-Laurent et à Hull (1933)
- N'étant pas le bienvenu au Québec, Elvis Presley offre deux prestations à Ottawa (1957)
- Les débuts de la Beatlemania au Québec (1964)
- En 1978 à Rock Forrest, un éléphant du cirque Gatini tue sa dompteuse
Tous les articles du blogue, classés par sujets
Tous les articles du blogue, classés par dates