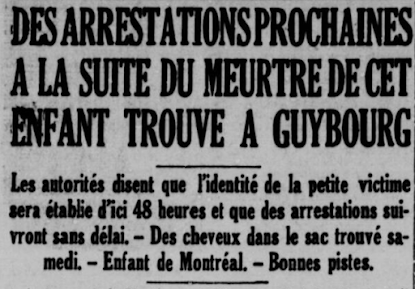Le 14 août 1950, alors qu'il navigue sur la rivière Saguenay, le SS Québec est dévasté par un incendie. Sept passagers trouvent la mort dans ce sinistre.
 |
| Le S.S. Québec (carte postale, source: BAnQ) |
Construit par la compagnie Davie Shipbuilding de Lauzon, le navire SS Québec avait été inauguré en grande pompe le 24 avril 1928 devant 450 invités, parmi lesquels se trouvaient le premier ministre du Québec Louis-Alexandre Taschereau et son épouse Adine Dionne.
 |
| L'Action Catholique, 24 avril 1928 |
Le SS Québec est un gros bateau à vapeur muni de deux hélices. Il est long de 359 pieds (109 m), large de 70 pieds (21 mètres) et profond de 21 pieds (6,5 mètres). Sa coque est en acier, alors que sa superstructure est en acier et en bois.
Pendant plus de vingt ans, le SS Québec est affecté à la ligne Montréal - Bagotville de la compagnie Canada Steamship Lines Limited. Il fait partie de la flotte des "bateaux blancs du Saint-Laurent", avec le SS Tadoussac, le SS Richelieu et le SS Saint-Laurent. Pendant tout l'été, ces paquebots offrent aux plaisanciers des croisières de quelques jours sur le Saint-Laurent et le Saguenay, avec des escales à Québec, La Malbaie, Saint-Siméon et Tadoussac.
 |
| Affiche publicitaire des Canada Steamship Lines Source: BAnQ |
Le 14 août 1950 alors qu'il vogue à l'embouchure du Saguenay avec, à son bord, 426 voyageurs et 197 membres d'équipage, un violent incendie éclate dans une lingerie du S.S. Québec. Deux passagères alertent des membres de l'équipage vers 17h, après avoir vu de la fumée. Quatre jeunes employés tentent d'éteindre les flammes au moyen d'extincteurs manuels, ce qui a pour seul effet d'intensifier la fumée. Ils utilisent ensuite des boyaux d'arrosage, mais la densité de la fumée les empêchent de s'approcher suffisamment du foyer de l'incendie.
Avisé de la situation, le capitaine Cyril H. Burch tente de s'adresser aux passagers par le système de haut-parleurs, mais aucun son n'en sort. De plus, le système de klaxons n'est audible que sur les ponts D et E, réservés à l'équipage, alors qu'on n'entend rien sur les ponts A, B et C, où se trouvent les passagers.
Les membres de l'équipage font de leur mieux pour alerter les passagers et les rassembler en trois groupes distincts sur les ponts du navire. Une certaine confusion règne car la fumée empêche certains employés de se rendre aux endroits où ils doivent remplir leur fonction en cas d'urgence. On constate qu'on ne dispose pas d'un nombre suffisant de vêtements de flottaison, car la plupart d'entre eux sont entreposées dans les cabines, devenues inaccessibles à cause de la fumée.
Puisque le S.S. Québec se trouve à une distance de 4 milles de Tadoussac, le capitaine prend la décision d'augmenter la vitesse du navire à son maximum afin de débarquer les passagers au quai de Tadoussac plutôt que de descendre les canots de sauvetage. Il accoste effectivement au quai de Tadoussac aux commandes du navire en flamme, et les passagers et membres d'équipages sont rapidement évacués.
 |
| SS Québec en flammes au quai de Tadoussac (source: BAnQ) |
Sept personnes, toutefois, ne descendent pas sur le quai. À cause de l'absence de klaxons d'alarme, elles sont mortes asphyxiées dans leur cabine.
Les victimes sont:
- Norman Shapiro de Ville Mont-Royal, son épouse et son fils Leonard (Bernard, un autre enfant de la famille Shapiro, a survécu).
- Eva et Gertrude Taub de Tarrytown, N.-Y.,
- le Dr. Piken-Smith McCollum et son épouse, de la Caroline Méridionale
 |
| Famille de Norman Shapiro. Bernard Shapiro (à gauche) est le seul survivant. M. et Mme Norman Shapiro et leur fils Leonard Shapiro sont morts dans l'incendie (Le Soleil, 17 août 1950) |
L'enquête conclut que l'incendie qui a détruit le S.S. Québec a été causé par une main criminelle. De plus, le système d'avertisseurs aéro-électrique avait été volontairement mis hors d'usage (les accumulateurs alimentant le système avaient été débranchés).
Le juge Choquette recommande néanmoins une meilleure formation de l'équipage pour faire face aux incendies: les flammes auraient probablement été maîtrisées si l'équipage avait immédiatement utilisé des boyaux plutôt que des extincteurs, et certains employés ne se sont pas présentés aux endroits qui leur avaient été assignés.
 |
| La Patrie, 10 avril 1951 |
Les autres navires de la Canada Steamship (le S.S. Richelieu, le S.S. Tadoussac et le S.S. Saint-Laurent) demeurèrent en service jusqu'à l'été 1965. En 1966, ils furent vendus à une compagnie belge afin d'être démantelés.
 |
| La Voix de l'Est, 15 novembre 1965 |
Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)
D'autres articles liés à l'histoire maritime:
- Les douaniers américains coulent la goélette canadienne I'm Alone
- Les péripéties du transatlantique Mount Temple.
- Le Dr. Crippen est arrêté pour meurtre après sa traversée de l'Atlantique (1910)
- Le naufrage du Mersey au large de Pointe-aux-Outardes (1903)
- En 1864, un train de passagers plonge dans la Rivière Richelieu, faisant près de 100 victimes.
- Un train fonce dans la gare Windsor à Montréal (1909) ¸
Tous les articles du blogue, classés par sujets
Tous les articles du blogue, classés par dates