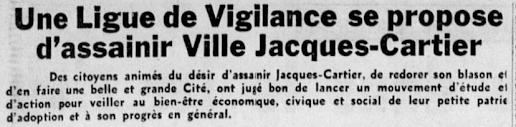Coups de bâtons, coups de poings...au début du XXe siècle, le hockey est un sport brutal... et aucun joueur ne porte de casque!
Dans cet article, nous combinons deux événements survenus à deux ans d'intervalle, qui présentent de nombreuses similarités: dans les deux cas, un jeune joueur de hockey meurt d'un coup de bâton à la tête pendant un match particulièrement violent, et son agresseur doit ensuite faire face à des accusations de meurtre au palais de justice de Cornwall, en Ontario.
1905: Décès d'Alcide Laurin, procès d'Allan Loney
 |
| La Presse, 1er mars 1905 |
Le 24 février 1905, Alcide Laurin, meurt des suites d'un coup à la tête asséné par Allan Loney, lors d'un match de hockey amateur à Maxville, en Ontario.
Joueur talentueux, Alcide Laurin, 24 ans, est le capitaine de l'équipe d'Alexandria. Il joue à la position "rover", qui n'existe plus de nos jours; contrairement aux 6 autres joueurs, le rover n'occupait pas une position précise sur la patinoire, il se déplaçait au gré des besoins, jouant parfois à l'attaque, parfois à la défense.
 |
| Alcide Laurin (La Presse, 2 mars 1905) |
Âgé de 19 ans, Allan Loney est un défenseur de l'équipe de Maxville. Il a la réputation de jouer d'une façon plutôt agressive.
 |
| Allan Loney, The Ottawa Journal, 27 février 1905 |
La population d'Alexandria est majoritairement francophone et catholique, alors que celle de Maxville est anglophone et protestante, ce qui contribue à exacerber la rivalité entre les deux équipes. Chaque partie de hockey ou de crosse impliquant ces deux localités amène son lot d'insultes et de gestes violents.
L'arbitre Bernard O'Connor considère que la partie du 24 février 1905 est le match de hockey le plus violent qu'il ait eu l'occasion de voir dans sa vie. Au moment où la moitié du temps est écoulé, il a déjà décerné 5 pénalités aux joueurs de Maxville, et deux à ceux d'Alexandria. Au début du match, Loney a même tenté d'intimider l'arbitre, le menaçant de s'en prendre à lui s'il continue de punir les joueurs de son équipe!
 |
| Bernard O'Connor (La Presse, 2 mars 1905) |
Allan Loney vient tout juste de soutirer la rondelle à Alcide Laurin lorsque ce dernier le frappe violemment aux jambes avec son bâton, qui casse sous l'impact. Selon plusieurs témoins, Laurin aurait également asséné un ou deux coups de poings au visage de Loney. Loney réplique en élevant son bâton au-dessus de ses épaules, et en l'abaissant violemment sur la tête de Laurin, juste au-dessus de son oreille gauche.
Alcide Laurin s'effondre immédiatement sur la patinoire, où il reste immobile. Son frère Léon, qui joue également pour l'équipe d'Alexandria, se rue sur Loney et l'abreuve de coups de poings. Dans les minutes suivantes, on constate avec consternation qu'Alcide Laurin est mort.
L'autopsie démontrera que le décès a été causée par une fracture de l'os temporal causé par un choc violent sur le côté gauche du crâne. Fracture est longue de 2 pouces et large d'un demi pouce.
Même si le décès a eu lieu à Maxville, l'enquête du coroner se déroule à Alexandria, le 3 mars 1905. Les jurés concluent alors qu'Alcide Laurin est décédé d'un coup violent porté à la tête par Allan Loney, et qu'il ne s'agissait pas d'un geste de légitime défense.
Par conséquent, Allan Loney est accusé du meurtre d'Alcide Laurin. La couronne réduira toutefois l'accusation à homicide involontaire.
Le procès d'Allan Loney s'ouvre à Cornwall le 28 mars. Cette fois, on prend soin de former un jury qui n'inclut aucun citoyen de Maxville ou d'Alexandria.
 |
| Léon Laurin (La Presse, 3 mars 1905) |
 |
| Le Canada, 31 mars 1905 |
Lors de sa déclaration, le président du jury déplore toutefois que les journaux glorifient les sportifs qui agissent en brute au hockey, à la crosse et au football. Il considère que ces sports devraient être interdits par la loi.
Lors de leur description de l'incident, les journaux québécois insistent beaucoup sur le fait que la victime est canadienne-française, contrairement à son agresseur. Le 6 mars, le journal La Presse annonce même qu'une équipe de hockey de Cornwall, entièrement composée de frères d'une même famille canadienne-française, lance un défi aux joueurs de l'équipe de Maxville. "Ces braves athlètes veulent montrer aux joueurs de Maxville comment on joue au hockey selon les règlements et sans s'assommer."
 |
| La Presse, 6 mars 1905 |
 |
| Les membres de la famille Charlebois: Olivier, Alonzo, Denis, Octave, Albert, Édouard, Aliter, Joachim, Alfred et Narcisse (La Presse, 6 mars 1905) |
1907: Décès d'Owen McCourt, procès de Charles Masson
 |
| La Presse, 8 mars 1907 |
Deux ans plus tard, le 6 mars 1907 Owen "Bud" McCourt est blessé à mort lors d'un match de la ligue fédérale de hockey opposant le Club de Hockey Cornwall aux Victorias d'Ottawa.
Owen McCourt est un attaquant de l'équipe de Cornwall; il est âgé de 22 ans. Il a l'habitude de jouer de façon agressive. Lors de ce match en particulier, il a de nombreux accrochages avec Arthur Throop, chacun des deux joueurs recevant une pénalité pour avoir frappé l'autre.
 |
| Owen McCourt (La Patrie, 8 mars 1907) |
À un certain moment pendant la partie, Charles Chamberlain frappe Owen McCourt à la tête. Furieux, McCourt se lance à la poursuite de Chamberlain et élève son bâton, dans l'intention de le frapper. Charles Masson intervient afin de protéger son coéquipier Chamberlain: il frappe McCourt à la tête avec son bâton. Owen McCourt s'effondre sur la patinoire, et il s'ensuit une mêlée générale pendant laquelle Zina Runions frappe Masson, et un joueur non-identifié frappe Arthur Throop à la tête.
 |
| Arthur Throop (La Patrie, 8 mars 1907) |
À la suite de cette échauffourée, deux joueurs sont sérieusement blessés à la tête: Arthur Throop, des Victorias d'Ottawa, et Owen McCourt du club de Cornwall. Throop décide de ne pas revenir au jeu, mais McCourt insiste pour continuer la partie après s'être pansé la tête avec un mouchoir.
Ce retour au jeu ne dure toutefois que quelques minutes: à cause de la gravité de sa blessure à la tête, McCourt est forcé d'abandonner à son tour. Appelé sur les lieux, le Dr Alguire fait transporter McCourt à l'hôpital, où on procèdes à une trépanation pendant la nuit. Owen McCourt décède à l'hôpital le lendemain matin à 8h.
L'enquête du coroner se tient à Cornwall le 13 mars 1907. Suite aux témoignages entendus, les jurés concluent qu'Owen MCourt est mort d'un coup à la tête asséné par Charles Masson, 22 ans, défenseur des Victorias d'Ottawa.
 |
| Charles Masson (La Patrie, 8 mars 1907) |
Procès de Charles Masson débute à Cornwall le 10 avril 1907, au même endroit où a eu lieu le procès d'Allan Loney deux ans auparavant. Masson est acquitté, car Owen McCourt a reçu plusieurs coups à la tête pendant le match (dont un par Charles Chamberlain, très peu de temps avant le coup porté par Masson), et il est impossible de déterminer lequel de ces coups lui a été fatal!
 |
| La Presse, 12 avril 1907 |
Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)
À lire également:
- Le décès d'Howie Morentz, joueur de hockey des Canadiens de Montréal, en 1937
- Décès du lutteur Stanley Stasiak, alors qu'il est en route pour Montréal, en 1931
- La dompteuse Éloïse Bechtold est tuée par un éléphant de cirque à Rock Forest, en 1978
- Ovide Desjardins est poignardé à mort pendant une représentation théâtrale, en 1895
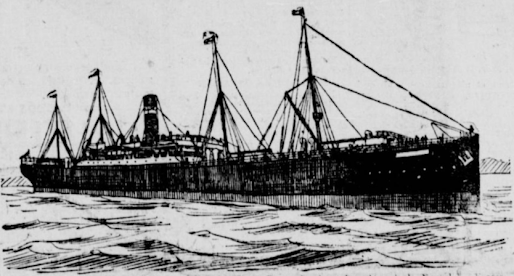







.png)