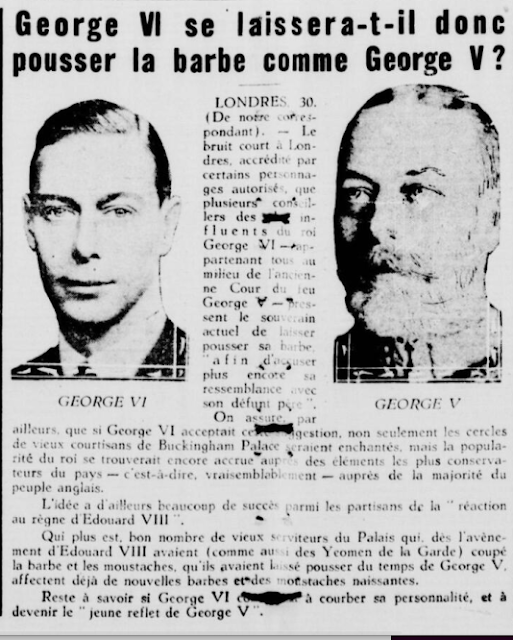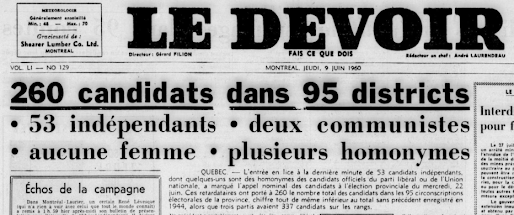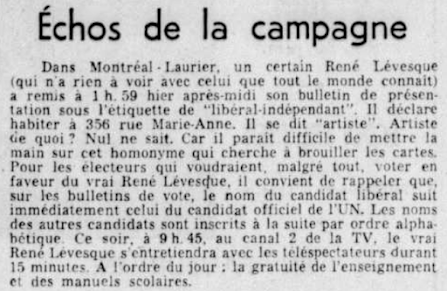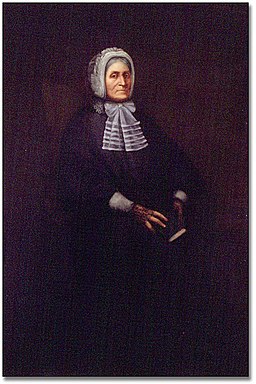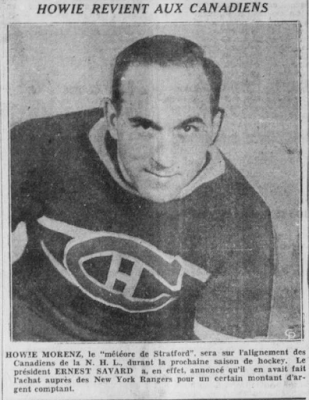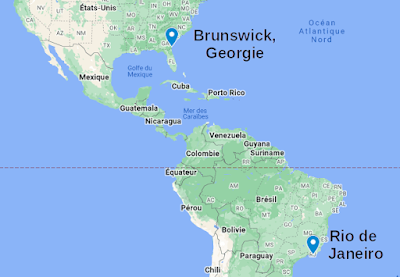Le 11 août 1957 vers 14h15, un avion quadrimoteur DC-4 de la compagnie Maritime Central Airways, qui transportait 73 passagers et 6 membres d'équipage, s'écrase à Issoudun, petite localité du comté de Lotbinière située à environ 25 km au sud ouest de la ville de Québec. Il n'y a aucun survivant.
Avec ses 79 victimes, cet écrasement est, à l'époque, l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation au Canada (ce triste record a depuis longtemps été battu, et est maintenant détenu par l'écrasement du vol Arrow Air 1285 à Terre-Neuve le 12 décembre 1985, qui a fait 256 victimes).
 |
| Le Soleil, 12 août 1957 |
Le DC-4 se dirigeait vers Toronto, après avoir décollé de Londres la veille. La plupart des passagers étaient des vétérans de l'armée canadienne qui revenaient d'un voyage en Grande-Bretagne. En cours de route, l'avion avait fait une unique escale à Keflavik, en Islande, afin de prendre du carburant.
Au moment de l'écrasement, un violent orage faisait rage: la pluie était abondante et il ventait très fort. Un peu plus tôt, des témoins ont vu l'avion qui volait à une altitude anormalement basse, en émettant un bruit inquiétant. Un agriculteur situé à plus d'un kilomètre du site de l'écrasement a senti la terre vibrer.
L'avion s'est écrasé dans un boisé marécageux plutôt difficile d'accès. Le pilote n'avait émis aucun message de détresse, mais des avions ont été envoyés en reconnaissance lorsqu'on a constaté que le DC-4 ne répondait plus aux messages radio. Un panache de fumée a facilité la découverte du site de l'écrasement. Vers 19h30, trois parachutistes sont descendus à partir d'un avion de l'Aviation Royale du Canada parti de la base de Trenton, en Ontario. Ils ont vite constaté qu'il n'y avait aucun survivant.
L'avion s'était enfoncé dans le sol marécageux, creusant un cratère de 8 mètres de profondeur, qui s'était aussitôt rempli d'une eau verdâtre. Autour du trou, des témoins ont pu voir des restes humains déchiquetés, des débris métalliques, des vêtements, des bagages...
Une vingtaine de policiers de la Gendarmerie Royale du Canada et de la police provinciale s'efforcent d'abord d'installer un câble autour du site afin d'en interdire l'accès aux curieux et autres chasseurs de souvenir. Toutefois, de nombreuses personnes étaient déjà sur place avant l'arrivée des parachutistes, et des enquêteurs confirmèrent plus tard que des parties importantes de l'avion avaient mystérieusement disparu, et que des sacs à main retrouvés sur le site avaient été vidés de leur contenu!
 |
| Le Soleil, 14 août 1957 |
Pendant plus de deux semaines, les enquêteurs collectent le restes humains, morceaux d'avions et effets personnels. La tâche est loin d'être facile: le sol est tellement spongieux qu'il est difficile d'y apporter la machinerie (une chenillette prêtée par l'armée s'est enlisée dans la boue). Une pompe du service des incendies est utilisée pour drainer le cratère mais, même après qu'on en ait retiré l'eau, on ne voit pas la carlingue de l'avion, qui est profondément enfouie sous la terre. On devra ensuite creuser le fond du trou pour trouver les débris.
L'impact a été tellement violent qu'aucun cadavre complet n'a été retrouvé. La seule victime formellement identifiée sera Gordon Stewart, troisième officier de bord, dont on a retrouvé le bras droit avec, à un doigt, une bague portant ses initiales (la bague sera formellement identifiée par son épouse lors de l'enquête du coroner). Les autres restes humains sont tellement déchiquetés qu'ils resteront anonymes. Dans les jours suivants, ces restes humains sont placés dans une dizaine de cercueils de bois et temporairement enterrés dans une fosse commune de fortune située à proximité du site de la catastrophe. Quatre mois plus tard, en décembre, les boîtes de bois seront exhumées et leur contenu transféré dans des cercueils de métal, qui seront envoyés par train à un cimetière de Toronto.
Les bagages et autres effets personnels seront aussi retournés à la légion Canadienne, à Toronto, qui tentera de les restituer aux familles des victimes.
Quant aux pièces de l'avion, elles sont soigneusement désinfectées, puis expédiées dans un entrepôt à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette, dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient expliquer la cause de l'accident.
Le 5 septembre, une enquête du coroner plutôt expéditive (moins de 2 heures suffisent à interroger les 10 témoins) en arrive à la conclusion que les décès sont accidentels et de cause inconnue.
 |
| La Presse, 6 septembre 1957 |
L'enquête publique annoncée par le ministre canadien des transports, toutefois, durera près de 3 semaines, du 6 au 24 février 1958, à Montréal. 47 témoins et experts seront entendus. Le but de l'enquête est de déterminer les causes de l'accident.
Nous y apprenons entre autres que:
- Le DC-4 était vieux de 15 ans. Il avait été fabriqué en 1944 par la Douglas Aicraft Company à Santa Monica, pour l'armée américaine. Après la guerre, il avait été vendu à la United Airlines, qui l'avait modifié pour qu'il puisse servir au transport de passagers. La Maritime Central Airways en était le 5e propriétaire. L'avion avait été inspecté à Montréal le 6 août, quelques jours avant la tragédie, et il semblait en bon était.
- Le plan de vol initial prévoyait une deuxième escale à Goose Bay (au Labrador), pour un ravitaillement en essence mais, pour une raison inconnue, l'avion à simplement poursuivi son chemin sans s'arrêter. 13 heures se sont écoulées entre le plein d'essence à Keflavik et l'écrasement.
- Un expert a d'abord calculé que l'avion n'avait pas assez de carburant pour atteindre Montréal. Il a ensuite modifié son calcul et est arrivé à la conclusion qu'il restait tout juste assez de carburant pour atteindre Montréal, de justesse. Un autre expert a plutôt affirmé qu'il restait assez de carburant pour voler 45 minutes après avoir atteint Montréal.
- Des experts ont calculé que l'avion était en surcharge d'environ 500 kg (1200 livres) lors de son décollage.
- L'état des débris permet de supposer que l'avion a frappé le sol avec une très grande vitesse, de l'ordre de 400 km/h (250 miles à l'heure). L'avion était probablement intact avant d'atteindre le sol. L'état des hélices permet de croire que les moteurs fonctionnaient encore au moment de l'écrasement.
- Une saturation d'oxyde de carbone de 10% dans les tissus de l'officier Gordon Stewart pourrait indiquer (sans qu'on puisse en en être certains) qu'il y a eu un incendie dans le cockpit avant l'écrasement. Cet incendie aurait été limité au cockpit, car les autres restes humains ne présentaient pas cette saturation d'oxyde de carbone. Les pièces de l'avion ne montrent aucun indice d'incendie à bord.
- L'état d'urgence avait été déclenché dans l'avion: les passagers avaient bouclé leur ceinture de sécurité.
L'enquête publique est rouverte le 13 novembre 1958, afin d'interroger un psychiatre montréalais qui avait traité Norman Ramsay, le pilote de l'appareil. Lors d'une séance d'hypnose, il avait découvert que Ramsay comprenait mal le fonctionnement des nouveaux altimètres, et qu'il souffrait d'une peur inconsciente de l'altitude. Quelques années auparavant, Ramsay avait été blâmé suite à un atterrissage d'urgence qui n'avais fait aucune victime.
Les commissaires déposent finalement leur rapport de 49 pages le 19 janvier 1959. Ils considèrent que l'écrasement a pu être causé par une erreur de jugement de la part du pilote: celui-ci aurait dû s’arrêter à Québec pour prendre de l’essence. Puisqu’il ne l’a pas fait, il ne disposait pas d’assez d’essence pour contourner l’orage et a été forcé de pénétrer dans la zone de perturbation atmosphérique, perdant ainsi la maîtrise de l’avion.
 |
| Le Soleil du 19 janvier 1959 |
Est-ce réellement ce qui s'est passé? Nous ne le saurons sans doute jamais...
Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)
À lire également:
Sources documentaires:
De nombreuses éditions du Soleil, de La Presse, du Devoir et de Montréal-Matin publié entre août 1957 et janvier 1959.
Tous les articles du blogue, classés par sujets
Tous les articles du blogue, classés par dates